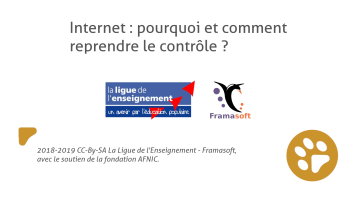
Connexion à MOOC CHATONS
Première visite sur ce site ?
L'inscription n'est pas nécéssaire pour accéder au contenu des leçons. Cependant, l'inscription est fortement recommandée pour pouvoir profiter pleinement du parcours pédagogique. Ainsi, avec un compte vous pourrez :
- accéder aux exercices d'autoévaluation
- suivre l'avancement de votre parcours de formation (pour reprendre une leçon là où vous vous étiez arrêté, ou pour suivre vos résultats aux évaluations).
- accèder à la messagerie, pour échanger en direct avec les autres apprenant⋅e⋅s.
- accèder au forum
- accèder aux annonces spécifiques du site (nouveautés, alertes, etc).
{ifminteacher}{/ifminteacher}